Article publié le 7 novembre 2017 pour Ombelliscience sur la plateforme Échosciences Hauts-de-France.
« Faites un geste pour l’environnement, optez pour la facture électronique« .
Au premier abord, il est assez tentant de penser que numérique rime forcément avec écologique. À vrai dire, le vocabulaire employé y est pour quelque chose : on parle bien de stockage dans le cloud (ou nuage), de format virtuel ou encore de dématérialisation.
On oublie donc l’ancrage matériel de cette affaire : tout comme l’électricité qui ne sort pas de notre mur, l’ordinateur qu’on achète n’est pas apparu dans un magasin, et la facture qu’on envoie par e-mail ne part pas littéralement dans les nuages.
Une consommation d’énergie colossale
Ce ne sera une surprise pour personne : le trafic Internet mondial est en pleine explosion. Il aurait été multiplié par 20 sur les dix dernières années pour représenter d’après Cisco plus d’un zettaoctet (mille milliards de milliards de gigaoctets) en 2016, soit une moyenne de près de 40 000 gigaoctets par seconde. Cela est dû à l’augmentation du nombre d’utilisateurs, mais aussi à l’évolution du contenu mis en ligne grâce à l’amélioration des débits : si initialement on ne partageait presque que du texte, le format vidéo représenterait actuellement près des trois quarts du trafic des particuliers, toujours d’après Cisco. Pour qualifier la hausse de production de contenu, Alain Cappy, professeur d’électronique à l’Université de Lille et ancien directeur de l’IEMN et de l’IRCICA, utilise l’expression de « déluge de données » (data deluge en anglais). Il faut dire que les préoccupations sont réelles : la Royal Society a suggéré qu’il était probable que les infrastructures de communication britanniques ne puissent bientôt plus suivre l’augmentation de la demande d’accès à Internet.
Naturellement, la facture énergétique mondiale du numérique est colossale et amenée à croître pour continuer de fabriquer et faire fonctionner de plus en plus d’équipements numériques et infrastructures réseau. S’il est difficile de trouver des chiffres à jour, on dispose d’une publication intéressante de l’Agence Internationale de l’Énergie datant de 2014 dont l’intitulé (More Data, Less Energy), correspond davantage à un souhait qu’à un constat. On y découvre que les technologies de l’information et de la communication auraient représenté déjà en 2013 au moins 8% de la consommation mondiale d’électricité. Cette valeur peut varier selon la méthode de calcul, mais l’ordre de grandeur reste de quelques pourcents. Du reste, il est prévu que cette consommation poursuive son augmentation exponentielle, en considérant que l’accès à Internet va continuer à se démocratiser (la moitié de la population mondiale est offline en 2017) et qu’on encourage le développement de nouveaux biens et services connectés.
Puisque l’électricité consommée doit être produite, cette facture énergétique s’accompagne fatalement d’une facture écologique, qui s’alourdit car l’amélioration de l’efficacité énergétique ne compense pas la croissance des usages. À ce stade, il convient de rappeler qu’à l’inverse du mix électrique français, l’électricité dans le monde demeure largement carbonée : deux tiers proviennent des combustibles fossiles, le charbon figurant toujours en première place avec 40% du total… Or, c’est cette même électricité qui vient alimenter et refroidir les data centers du monde entier.
Mettre un document dans le « cloud » revient donc bien à envoyer du carbone dans les nuages. À ce sujet, Greenpeace publie depuis 2010 des rapports sur l’origine de l’énergie utilisée pour les data centers des grandes entreprises du numérique (en faisant le choix de mettre sur un même plan fossile et nucléaire, ce qui peut être discuté à l’heure de l’urgence climatique). Mentionnons toutefois que le numérique, bien utilisé, est susceptible de permettre de grandes économies d’énergie par ailleurs. Malheureusement, ces bénéfices sont souvent compensés par l’effet rebond : les opportunités du numérique créent de nouveaux besoins et de nouvelles activités.
Vers des machines moins énergivores ?
Cette débauche énergétique est liée à l’architecture et à la technologie CMOS implémentée dans les processeurs actuels. Une large fraction de l’énergie alimentant les circuits est perdue par effet Joule, à l’origine de la chaleur dégagée par les appareils électroniques que tout le monde a déjà pu constater. Pour des raisons fondamentales, il est devenu difficile de réduire ce gaspillage, ce qui est en partie à l’origine de la stagnation de la fréquence d’horloge des processeurs commerciaux depuis les années 2000. En effet, au-delà d’une cadence de quelques GHz, les ventilateurs embarqués ne suffisent plus à refroidir les processeurs.
Ces obstacles poussent certains scientifiques à considérer des alternatives aux architectures des machines actuelles. On pourra citer l’approche neuromorphique, qui prend le parti de s’inspirer des systèmes nerveux biologiques. En effet, le cerveau humain est une machine biologique qui stocke et traite l’information pour quelques dizaines de watts seulement et représente donc un modèle remarquablement économe en énergie. Dans le cadre du projet SPINE, des chercheurs de l’IRCICA et l’IEMN à l’Université de Lille ont récemment proposé un neurone artificiel sur silicium « consommant cent à mille fois moins d’énergie qu’un neurone biologique« . Pour faciliter l’interface avec les machines classiques, ils ont choisi la technologie CMOS, alors que d’autres équipes étudient des technologies alternatives. Non loin de là, l’équipe Émeraude du laboratoire CRIStAL travaille sur la conception d’architectures à base de réseaux de neurones virtuels, simulés sur ordinateur classique. Pierre Boulet, professeur à l’Université de Lille, et Philippe Devienne, chargé de recherche au CNRS, précisent que l’énorme potentiel des systèmes neuromorphiques « réside dans leur très grande efficacité énergétique pour des tâches de reconnaissance vocale ou visuelle, plutôt que dans le calcul arithmétique brut sur lequel excellent nos ordinateurs actuels« .
Ainsi, le neuromorphique viendrait en complément, et ne saurait donc résoudre pleinement la situation, tandis que d’autres solutions comme le recours au calcul quantique ne seront pas prêtes de sitôt. Mais le temps presse, et une part de la difficulté réside dans ce que les solutions sont aux mains d’acteurs distribués (fabricants, pouvoirs publics, particuliers…) peu ou pas conscients du problème et sans incitation à agir. À titre individuel, changer ses habitudes de consommation numérique est un levier de réduction de son empreinte environnementale : on pourra par exemple songer à réparer plutôt que remplacer un téléphone au moindre problème ou nouveau modèle, éviter de stocker trop de données dans le cloud et d’envoyer des pièces jointes inutiles. Au niveau global, la contrainte énergétique pose la question de la pertinence – voire de la faisabilité – d’un développement effréné du numérique à long terme, avec des milliards d’objets connectés et d’appareils allumés en permanence ou en « veille » connectée. Étant donnés les enjeux environnementaux, il est crucial de réaliser les risques que représente la synergie entre aspirations des consommateurs et logiques commerciales sur un marché numérique débridé.
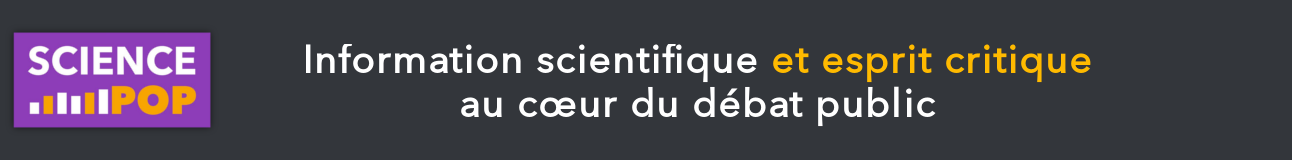







Arthur
Je trouve que l’article est très mal orienté, le sujet mélange la consommation de CO2 liée à Internet (ou plus particulièrement aux serveurs) et l’usage personnel du cloud/numérique. Pourquoi ça m’énerve ? Ca fait faire des raccourcis au lecteur sur son impact direct alors que l’article ne traite pas de ça.
– Le titre parle de l’envoi d’un fichier dans le cloud et l’image principale c’est une usine polluante sous nos doigts. On en retient que ce simple geste est polluant alors que c’est vraiment peanuts comparé à l’ensemble de nos actions sur internet. Et si l’association n’était pas encore faite, on en rajoute avec le premier sous-titre : « Une consommation d’énergie colossale ». Alors qu’on parle bien du traffic internet global, incluant le streaming par exemple (et même du big data en général).
– Si le but est vraiment d’impliquer le lecteur pas la peine de parler de neuromorphique ou d’ordinateur quantique (bon au moins on se marre bien). Ca manque d’un graphique sur les facteurs polluants du numérique comme tu l’avais fait dans ton article sur l’empreinte carbonne de janvier. En guise de conclusion tu te contentes de citer (maladroitement) un document pour réduire les impacts du numérique sur l’environnement.
En développant un peu ton lien vers les rapports de Greenpeace on peut tirer des informations intéressantes sur ce qu’on peut favoriser/boycotter. Si l’aspect du streaming avait été abordé on par exemple on pourrait faire remarquer que Netflix est pas très vert (et parler du P2P).
Au demeurant, je prends le temps de détailler ma critique car je salue l’initiative du café des sciences et de ce blog.
TLDR : Mélange et confusion des termes numérique, internet et cloud pour parler des facteurs écologiques. Des liens externes à gogo mal exploités.
Théo
Merci de votre critique détaillée.
Il me semble que votre insistance sur la distinction entre numérique/internet/cloud ne soit pas cruciale, d’autant que vous n’expliquez pas en quoi elle serait particulièrement profitable au propos ici. Cet article traite de tout le package : les technologies de l’information émettent du fait de la fabrication et de la consommation de tous les appareils et infrastructures nécessaires à la mise en ligne du contenu et à sa consultation, des terminaux aux serveurs. Que l’on parle de streaming ou non n’y change rien, et le titre ne touche qu’un aspect du sujet de l’article. On part du particulier pour aller vers le général.
Par ailleurs, de nombreux compromis sont nécessaires pour la rédaction d’un tel article d’environ 1000 mots afin de traiter le problème avec une certaine globalité (tout en restant conscient qu’on ne fait qu’égratigner la surface, ce qui est très souvent le cas dans nos articles). Le but est surtout de faire passer un message qui soit suffisamment clair sans être trompeur, avec les sources permettant au lecteur intéressé d’aller plus loin.
Aur_
Super intéressant !
Théo
Merci du retour positif !