Le mois dernier, j’écrivais dans un article sur Medium que la couverture médiatique française autour de la pêche électrique avait été sérieusement défaillante. J’ai cherché à montrer en quoi le discours catastrophiste véhiculé ne se fondait pas sur des éléments solides, et la manière avec laquelle la science avait été instrumentalisée au sein de la campagne, très proéminente, de Bloom. Après avoir pris connaissance de mon article, Bloom a décidé de répondre. Je remercie les auteurs pour l’effort fourni ainsi que le souci de traiter spécifiquement les points soulevés.
Puisque ma motivation a été questionnée, il me faut d’abord prendre le temps de l’expliciter à nouveau, même si elle me semble claire dans l’article comme ailleurs.
Quand on parle d’environnement, on a intérêt à prendre nos décisions à la lumière des meilleures connaissances scientifiques disponibles, ceci afin d’éviter de prendre des mesures contre-productives. Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il faille protéger les habitats et la biodiversité des fonds marins, l’idéal pour cela étant de diminuer drastiquement la pression de pêche. Mais la réalité, c’est que tant que les Européens continueront de manger autant de poisson (et que l’aquaculture nécessite des farines de poisson), l’exploitation massive des ressources halieutiques se poursuivra. Il est donc nécessaire d’évaluer les impacts des différentes techniques de pêche, au regard de leur potentiel de production. Voilà pourquoi il est important de faire de la recherche, et de présenter aux citoyens de façon honnête les résultats de cette recherche, ainsi que ses limites, tout en contextualisant correctement le propos (et ce même si l’objectif principal est d’influencer l’opinion plutôt que d’informer). Des ONG comme WWF avaient par exemple fait un très bon travail de synthèse dès 2014 sur l’utilisation de chaluts électriques pour la pêche à la crevette grise.
Or, ce n’est clairement pas la démarche choisie par Bloom. Force est de constater que leur argumentaire repose en partie sur des raccourcis simplistes et une manipulation des données scientifiques, pratiques relativement courantes dans les campagnes militantes de ce type. En effet, déformer la réalité pour justifier une démarche fait partie de la boîte à outils du militant. Dans ma critique, je ne me suis pas positionné pour ou contre la pêche électrique, mais je me suis plutôt attaché à pointer les éléments qui ne tiennent pas la route dans l’argumentaire de Bloom. Notons que cela ne légitime pas pour autant la position opposée (en faveur d’un développement massif de la pêche électrique).
L’objectif de l’article initial est tout à fait atteint, et les justifications apportées par Bloom échouent à remettre en cause le propos central. Par ailleurs, l’examen critique de leur réponse révèle la faible portée argumentative des contre-critiques qu’elle contient, mais aussi certains points de convergence ayant conduit à des modifications mineures de l’article original. Pour sa part, Bloom n’a jusqu’à présent pas modifié son argumentaire, bien qu’il contienne des informations manifestement fausses ou infondées. C’est notamment le cas d’une part à propos de l’impact des impulsions électriques sur les cabillauds (fractures) et les vers et les crevettes (affaiblissement du système immunitaire), et d’autre part à propos du rôle de la pêche électrique en elle-même dans les difficultés rencontrées par les pêcheurs français.
Pour les plus motivés, ci-dessous se trouvent quelques points sur lesquels il m’a semblé pertinent de réagir, en reprenant des citations de la réponse de Bloom. Considérant que mon argumentaire est largement assez clair avec l’article original et les précisions qui suivent, je ne pense pas utile de poursuivre par la suite.
Cliquer ici pour la réponse détaillée.
Bloom commence :
Dès son titre, l’auteur du pamphlet adopte le parti-pris des raccourcis et inexactitudes, deux choses qu’il annonce pourtant combattre par souci d’analyse critique… D’un point de vue sociologique, ce titre est un objet d’étude en soi car il coche toutes les cases du titre « clickbait », créé pour générer un maximum de clics.
Gardons en tête que l’on parle d’un petit article austère sur Medium, dont le titre, certes simplifié, correspond bien au contenu de l’article.
Plus bas Bloom critique le fait que le chalutier en illustration de mon article soit non-électrique. Au-delà du fait que je trouve cette remarque futile, je tiens à dire que le choix a surtout été contraint par l’absence d’image de chalutier électrique qui soit libre de droit… Toujours est-il que Bloom a donc besoin de zoomer sur l’image que j’ai utilisée pour trouver le nom du chalutier et vérifier sur Internet qu’il s’agit bien d’un chalutier non-électrique pour me blâmer.
Sans vouloir tomber dans le simple tu quoque, cette critique est très maladroite venant de Bloom, adepte des illustrations chocs. En effet, leur campagne contre la pêche électrique s’est appuyée sur des images complètement absurdes montrant un poisson électrocuté avec, tenez-vous bien, des arcs électriques (oui oui, dans l’eau de mer avec une tension max de 50 V sur 40 cm) et un squelette apparent (comme s’il passait une radio à rayons X). Certes, ces visuels sont sûrement d’une efficacité redoutable d’un point de vue communication, mais à mettre en avant de telles inepties, on renonce de fait à toute prétention à une quelconque rigueur intellectuelle.
La paille et la poutre, ça vous dit quelque chose ?
Par ailleurs, les avis — hautement politiques et prudents mais loin d’être positifs — du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM) cités par l’auteur suffisent-ils à générer un discours des chercheurs qui démolit notre campagne ? Soyons sérieux… Quid des chercheurs en halieutique qui ont pris position contre cette technique de pêche ? Comme Didier Gascuel, Callum Roberts, Rainer Froese, Daniel Pauly, ou encore Marta Coll, tous signataires d’une tribune publiée dans Le Monde le 15 novembre ? Quid d’Olivier Le Pape, qui remet en question la stratégie des Néerlandais? Quid de nos chercheurs, salariés chez BLOOM ? Comment se fait-il que l’auteur de l’article ne les ait pas interrogés ?
Si on lit les avis du CIEM, ils remettent bien en cause l’alarmisme de la campagne de Bloom dans le sens où on se rend compte que rien ne justifie ce discours catastrophiste. Alerter sur l’absence de recul et appeler à la prudence, ce n’est pas la même chose que de communiquer agressivement sur une catastrophe écologique avérée.
Bloom propose une liste de chercheurs en halieutique qui se sont exprimés à titre individuel (mais qui n’ont pas directement contribué à la littérature scientifique correspondante). Premièrement, il faut voir ce qu’ils disent effectivement : Didier Gascuel pointe l’absence de connaissances scientifiques, de même pour Callum Roberts qui prédit — on ne sait comment — que la recherche prouvera qu’il faut interdire la pêche électrique. Concernant Olivier Le Pape, difficile de voir en quoi sa citation — en soi discutable s’il fait référence au chalut électrique, qui est légèrement plus sélectif et moins « productif » que le chalut à perche — colle avec ce qu’en rapporte Bloom.
La tribune, dont je n’avais pas connaissance, est quant à elle peu documentée. Elle ne se base pas sur autre chose que le témoignage de pêcheurs et un vieux texte de loi d’Hong Kong (dont le contenu est aujourd’hui peu pertinent, la recherche ayant montré que les impulsions utilisées en mer du Nord ne tuent absolument pas « la plupart des poissons »). À ma connaissance, il y a également méprise sur la raison du développement des chaluts électriques aux Pays-Bas. Tout cela pose question : les signataires ont-ils fait un travail de bibliographie avant de publier leur tribune ? Quant aux chercheurs de Bloom eux-mêmes, les solliciter n’aurait eu que peu d’intérêt, puisque leur avis était déjà bien étayé dans les écrits de l’association (et qu’ils ne travaillent pas sur la thématique).
La qualité de la recherche néerlandaise — que nous avons dû utiliser faute de recherche indépendante réalisée par des laboratoires universitaires ou, par exemple, ceux de l’Ifremer — a déjà été épinglée plusieurs fois et nous sommes en train de développer cet aspect dans une mise à jour de notre document de plaidoyer. Si les données concernant la pêche électrique présentées dans notre document de plaidoyer sont critiquables, c’est donc parce que nous avons utilisé la « recherche » produite par les néerlandais.
Non, si le plaidoyer de Bloom est critiquable, ce n’est pas la faute de la recherche, mais justement parce qu’il ne reflète pas le contenu de la recherche.
Il ne suffit pas de dire que la recherche est mauvaise pour que cela devienne vrai. Il faut proposer une critique effective, pour l’instant absente de l’argumentaire de Bloom. On attend donc la mise à jour du plaidoyer pour voir en quoi les conclusions des chercheurs seraient invalides. Mais n’est-ce pas plus tôt qu’il aurait fallu faire ce travail ? Voilà qui conforte l’idée que la science passe au second plan pour Bloom.
En fait, Bloom insinue que la recherche néerlandaise ne serait pas indépendante des intérêts économiques, ce qui la disqualifierait. Or, rejeter gratuitement les publications qui nous dérangent sous prétexte de liens, réels ou supposés, avec des entités « ennemies » constitue une réaction très courante mais finalement assez immature. Soit on considère que les études ne sont pas de bonne qualité méthodologique, et dans ce cas on peut le montrer et publier avec de meilleurs standards, soit on considère que les études rapportent des résultats volontairement trompeurs ou faux, ce qui revient à accuser les chercheurs de malveillance voire de fraude. Or dans ce second cas, si on ne dispose pas d’éléments de preuve solides permettant de porter de si graves accusations, il serait préférable de se taire.
Cette posture de méfiance s’inscrit naturellement dans une vision manichéenne de la situation, où l’on oppose de façon naïve les gentils contre les méchants, les artisans contre les industriels, les Français contre les Néerlandais, les ONG contre les lobbies… Notons au passage que la recherche est bel et bien menée par des universitaires et académiques, que ce soit aux Pays-Bas avec l’institut Wageningen, ou en Belgique à l’ILVO où travaille Maarten Soetaert. D’après Bloom, ce dernier « produit une recherche aussi critiquable que celle de ses collègues néerlandais ». Encore une fois, affirmer de façon péremptoire qu’elle est critiquable n’a aucune valeur : si elle est critiquable selon vous, et bien allez-y, étayez votre critique. Peut-être serait-il bénéfique que Bloom aille rencontrer ces chercheurs pour voir si cette hostilité de principe paraît justifiée.
Cependant, notez que notre campagne n’était majoritairement pas basée sur les conséquences environnementales de la pêche électrique, mais bien sur le scandale politique qu’elle représente.
Certes il y a des éléments politiques à considérer et qu’on peut tout à fait mettre en avant. Mais il faut bien réaliser que c’est bien parce qu’on imagine que la pêche électrique est une catastrophe écologique qu’il s’agirait d’un scandale, autrement Bloom n’aurait pas fait campagne. D’où l’importance d’examiner leurs affirmations à ce sujet. Pour le coup, leur plaidoyer est assez clair : dès l’introduction, on peut lire que « l’utilisation de l’électricité dans la nature a de graves conséquences environnementales et socioéconomiques : non seulement le fond marin est impacté par d’énormes filets industriels, mais toute la vie marine est également électrocutée » . Qu’on-t-ils pour soutenir ce diagnostic catégorique ? En réalité, pas grand chose.
BLOOM est effectivement une ONG environnementale et militante, dont les combats se fondent sur des analyses scientifiques rigoureuses. En l’occurrence, notre équipe de chercheurs est composée, entre autres, de deux docteurs en sciences halieutiques et d’une doctorante en Science politique. Être accusés de faire passer « les objectifs militants […] avant l’honnêteté intellectuelle et le respect de la science » est donc plutôt étonnant. […] Si BLOOM n’était pas rigoureuse, elle ne pourrait pas résister aux lobbies industriels et n’aurait pas les résultats qu’on lui connaît.
Il est très difficile d’être militant et de veiller à la rigueur de son discours, puisqu’un propos extrême mais trompeur est souvent plus efficace qu’un propos nuancé mais honnête. Pour beaucoup, la fin justifie les moyens.
Concernant le combat contre la pêche électrique qu’a mené Bloom, j’ai justement montré qu’il ne s’est manifestement pas basé sur des « analyses scientifiques rigoureuses ». Ce n’est pas parce que l’association a une équipe de scientifiques que cela les immunise contre la tentation très humaine de grossir le trait.
Enfin, il est évident que la rigueur n’est de nos jours pas du tout nécessaire au succès d’une ONG. Les ingrédients sont connus : flatter les a priori technophobes, faire des appels à la nature, faire peur, diaboliser des acteurs économiques… Le simple positionnement d’ONG luttant contre des « industriels » confère une aura positive qui convainc d’emblée une bonne partie de l’opinion publique, indépendamment de la qualité du discours sur le plan scientifique. Pour s’en rendre compte, il suffit de considérer la portée spectaculaire des campagnes de Générations Futures malgré la qualité lamentable de leur travail. Il n’y a aucune raison de penser a priori qu’une ONG diffuse une information parfaite : les biais idéologiques des militants peuvent être très forts.
L’auteur affirme qu’il n’y a pas eu de discours contradictoire à notre campagne. On ne pourrait être plus éloigné de la réalité, car si notre campagne s’appuie sur près d’un an d’investigation sur l’historique de la pêche électrique et sa mise en place à l’échelle que l’on connaît en Europe, les Néerlandais ont pu affirmer ce qu’ils voulaient pendant 10 ans, sans aucune forme de contradiction.
Je n’ai pas dit qu’il n’existait pas de discours contradictoire, mais simplement qu’il n’y en a quasiment pas eu dans la couverture médiatique en France : on aura du mal à trouver un article nuancé ou apportant des éléments de contradiction. Je ne nie pas qu’un discours pro-pêche électrique existe au niveau politique ou bien à l’étranger.
Bloom cite un reportage de France 2 pour affirmer que le point de vue des « lobbies néerlandais » a été présenté, ce qui est assez ridicule. Quiconque regarde ce reportage pourra se rendre compte qu’il est tourné de façon à laisser la parole aux promoteurs de la pêche électrique pour mieux les contredire.
Dans l’article de Médium, les dires des Néerlandais suivant lesquels la bataille contre la pêche électrique serait franco-française sont répétés à l’envie.
Voilà une remarque bien étrange… Je n’ai certainement pas dit que la mobilisation contre la pêche électrique était franco-française, mais j’ai constaté que la mobilisation en France a été largement en opposition à la pêche électrique, à en juger par la couverture médiatique. D’un point de vue logique, confondre ces deux propositions revient à confondre« tous les cabillauds sont des poissons » avec « tous les poissons sont des cabillauds ». Partant de cette grossière erreur d’appréciation, le paragraphe en question n’a aucun autre intérêt que de montrer l’ardeur de Bloom à se battre contre un épouvantail.
L’auteur note que les « difficultés [des pêcheurs français] découlent probablement plus d’une compétition locale trop importante entre différentes techniques de pêche pour la même ressource, dont l’évolution est complexe, que de la pêche électrique per se », citant un article scientifique publié en 2016. C’est intéressant… mais il y a un hic : les données de cet article ne s’étalent que de 2006 à 2013, et s’intéressent à la flotte de chalut à perche belge et non aux fileyeurs français, anglais, ou belges.
Bloom continue en expliquant que les chalutiers électriques ne sont arrivés en masse qu’à partir de 2014. Cependant, ma référence à la publication sur la compétition avait pour seul but de rappeler qu’il était normal que la cohabitation de différentes techniques de pêche au même endroit pour la même ressource puisse avoir des conséquences négatives sur l’une ou l’autre des techniques. L’article cité montre que ce fut le cas pour les chalutiers belges, et ce avant même le déploiement massif de chalutiers électriques. On peut imaginer que quelque chose de similaire puisse se passer au détriment des fileyeurs, ce sur quoi je reviens plus bas. Notez également la présence de l’adverbe « probablement » dans ma formulation.
Les pêcheurs artisans avec lesquels nous collaborons ne sont pas adeptes des chaluts conventionnels, mais ils disent qu’avant l’avènement de la pêche électrique, il était possible de cohabiter. Tout le monde trouvait sa place. Cela n’est plus le cas avec la pêche électrique.
On aura vu mieux que des témoignages pour statuer sur des questions de ce type (témoignage = niveau 0 de la preuve). Si on se tient au constat des difficultés que les pêcheurs rencontrent, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un simple post hoc ergo propter hoc. Or, la succession de deux événements n’est pas suffisante pour établir un lien de cause à effet. Pour autant, comme dit plus haut il est bien possible que l’arrivée des chalutiers électriques ait pu avoir un impact négatif sur les fileyeurs, mais pas forcément à cause de l’introduction de l’électricité en elle-même. Pour pouvoir conclure, il faudrait adopter une démarche beaucoup plus rigoureuse, et entre autres vérifier si, avant l’arrivée de chalutiers électriques, il y avait un effort de pêche comparable par chalutiers de fond sur les zones concernées. Cet élément peut être mis en doute dans la mesure où, et c’est d’ailleurs un des arguments de Bloom, les chalutiers électriques concurrencent les fileyeurs sur des zones historiquement non accessibles aux chaluts à perche, trop lourds. En définitive, la désignation de l’utilisation de l’électricité comme responsable certain des problèmes des pêcheurs français est un élément central du discours de Bloom, mais n’est tout simplement pas démontré.
De plus, comme je le rappelle dans mon article, les évaluations des stocks de sole pour la mer du Nord font état d’une amélioration récente.
L’auteur insinue que, contrairement au chalut conventionnel, le chalut électrique est une bonne alternative car il ne « balaye pas les fonds marins mécaniquement » (bien qu’il ne parle plus ensuite que de « limitation sensible » de l’impact physique). On retrouve ici l’un des mensonges éhontés du lobby néerlandais, qui prétend que leurs chaluts de plusieurs centaines de kilos et 12m de large « survolent le fond, le laissant vierge de tout contact ».
Comme souligné, je note dans l’article qu’il ne s’agit que d’une question de degré. Le propos était de dire que ce n’est pas le contact physique qui déloge les poissons. L’article a été modifié pour retirer cette ambiguïté.
Concernant la problématique des zones maintenant accessibles aux chalutiers électriques, ne peut-on pas imaginer qu’une évolution de la réglementation puisse régler ce problème ?
Nous nous appuyons « sur l’interdiction de la pêche électrique en Chine pour affirmer que la technique est dévastatrice pour la biodiversité«. L’article cité pointe certes du doigt l’absence de régulation, mais le problème se pose aussi en Europe : l’augmentation du nombre de navires utilisant l’électricité a été totalement incontrôlée, en opposition complète avec le principe de précaution selon le CIEM et sans que des garde-fous ne soient mis en place pour empêcher l’introduction d’impacts négatifs, toujours selon le CIEM.
Si on reconnaît que l’article pointe du doigt l’absence de régulation, il n’est pas honnête de citer cette publication pour soutenir l’idée que la pêche électrique a été interdite en Chine à cause de « ses impacts sociaux et environnementaux dramatiques ». Il peut exister un bon compromis entre dérégulation et interdiction totales : on pourrait limiter le nombre de chalutiers électriques afin de laisser la recherche progresser, par exemple en faisant appliquer la règle des 5% et en annulant les dérogations néerlandaises.
Je n’ignore pas que les espèces visées ne sont pas les seules espèces à être affectées. Toutefois, il est facile de parler de menace pour la biodiversité sans expliciter. Quelles sont spécifiquement ces menaces ?
Il est vrai qu’il existe de grandes zones d’ombres sur les effets long terme de la pêche électrique, c’est un point sur lequel mes diverses sources m’avaient averti et que j’ai bien rappelé dans l’article. Notamment, il faudrait davantage de recherche au sujet des effets des impulsions sur les juvéniles, sur la métamorphose des poissons plats et sur des adultes en phase de maturation sexuelle. Concernant les manquements des études sur les requins, j’admets la pertinence du point soulevé par Bloom.
[…] nous utilisions l’argument des colonnes vertébrales brisées pour contredire l’argument néerlandais suivant lequel le courant électrique utilisé est bénin et ne servirait qu’à « stimuler les réflexes naturels des poissons ». Que ce soit jusqu’à 70% de fractures en laboratoire ou moins dans des conditions plus réalistes n’est pas ce qui importe ici, tout comme le fait que les poissons remontés sur le pont sont morts de toute façon, que ce soit par fracture de la colonne vertébrale ou baro-trauma : quand on brise des colonnes vertébrales, ce n’est pas bénin et donc, nous supposons un impact conséquent sur l’écosystème marin dans son intégralité.
Bien sûr que le pourcentage importe. Si les promoteurs de la pêche électrique affirment que les impulsions sont complètement bénignes, ce n’est pas une raison pour affirmer des choses fausses en retour (justement…). Ces chiffres de 50-70% ont été fortement mis en avant dans le plaidoyer de Bloom et répétés dans de nombreux articles, dans un reportage France 2, et par Frédéric Le Manach interviewé dans une vidéo du journal Le Monde. Répéter une donnée scientifique sans contextualisation appropriée, c’est par définition de l’instrumentalisation, et c’est donc bien mettre l’objectif militant avant le respect de la science. Pire, quand Bloom dit que « Ces contractions sont si violentes que 50 à 70% des cabillauds de grande taille capturés au moyen de cette technique ont la colonne vertébrale fracturée et présentent des hémorragies internes ! » alors que la réalité est plutôt autour de 10%, le discours n’est plus trompeur mais carrément mensonger.
Mentionnons également que les impacts sont d’autant plus forts que l’animal est grand (plus grande différence de potentiel). Les jeunes cabillauds sont par exemple moins affectés. Ainsi, on ne peut pas conclure, sur la base d’effets sur les cabillauds adultes, que l’impact des impulsions sur les écosystèmes soit conséquent. Encore une fois, la vérité est que l’on est dans l’inconnu, mais Bloom met en avant des risques comme s’ils étaient avérés.
Dans notre plaidoyer, nous disons que l’électricité peut avoir un effet sur le système immunitaire des invertébrés, car les conclusions des études ne sont pas formelles. Il y a donc « possibilité », ce qui n’a pas été infirmé.
Bloom a factuellement tort sur ce point, et tente un glissement sémantique pour sauver son propos. Rappelons que les vers explicitement cités par Bloom n’ont en réalité jamais été concernés, et que le lien pour les crevettes ne s’est pas reproduit dans une expérience aux conditions pourtant plus sévères. On ne peut pas infirmer l’existence d’un lien, puisque prouver un négatif est de toute manière formellement impossible, mais on n’a pas non plus de raison de le suggérer. Il est donc injustifié de dire que les impulsions électriques peuvent affaiblir le système immunitaire des invertébrés. En date du 20 mars, cette intox est pourtant toujours en ligne sur le site de Bloom.
Les Néerlandais ont souvent argué que lutter contre la pêche électrique revenait à favoriser le chalut à perche, qu’il n’y avait pas d’autre alternative. En réalité, les pêcheurs néerlandais ne se reconvertiront pas au chalut à perche, contrairement à ce qui est affirmé par l’auteur de l’article, car ils savent très bien que leur faillite sera alors assurée.
Il est au contraire très probable que ces pêcheurs reviendraient plutôt au chalut à perche. Pourquoi ? Pour la même raison que ce qui les a initialement poussés à passer au chalut électrique. Ces métiers sont très proches, alors qu’il faudrait des années pour apprendre le métier de fileyeur qui n’a rien à voir. Même s’ils sont déficitaires comme en 2005, il y a de bonnes raisons de penser que l’activité demeurera un bon moment, à coups de subventions publiques s’il le faut. Depuis 2015, les prix du gazole sont plus bas et les chalutiers à perche redeviennent profitables.
Il existe d’autres alternatives pour pêcher les soles et les plies dans la même zone, comme le filet maillant utilisé par les Français et les Britanniques, dont l’impact physique sur les habitats, la quantité de « captures accessoires » et la consommation de carburant sont radicalement plus faibles que ceux du chalut à perche. Alors pourquoi les pêcheurs néerlandais ne se convertissent-ils pas à ces méthodes ? […] Et que dire de l’assertion de l’auteur de l’article dans Médium : « Il n’est pas certain que ces techniques permettent d’atteindre les TAC si elles étaient amenées à être généralisées en mer du Nord. Cela serait une bonne nouvelle pour les écosystèmes, mais les consommateurs européens risquent de ne pas apprécier« . Qu’en sait-il ?
La seule existence de ces alternatives ne veut pas dire que les pêcheurs néerlandais se tourneront vers elles, cf point précédent.
D’autre part, les techniques de pêches citées ont un impact physique moindre sur les habitats, et font moins de captures accessoires, c’est vrai. Par contre, elles ne pêchent pas beaucoup de poisson. Ainsi rien ne dit a priori que le bilan carbone ramené à la quantité de poisson pêché soit avantageux par rapport aux chalutiers. Cela pourra être vérifié sous peu avec les chiffres fournis par la base de données Agribalyse de l’Ademe.
En se basant sur les chiffres de l’UE, Bloom indique que « [la pêche artisanale] débarque moins de 1% des volumes de poissons mais emploie 18% des pêcheurs, ce qui correspond à 6% des emplois à temps plein ». Une simple règle de trois suggère qu’au premier ordre les TAC ne seront pas atteints si la totalité de ceux utilisant des chaluts électriques se convertissaient à ces métiers (à moins que les effectifs des pêcheurs augmentent significativement). Je ne dis pas que ce serait forcément une mauvaise chose : je fais partie de ceux qui pensent qu’on devrait tant que possible affaiblir la pression des humains sur l’environnement, et que cela impliquerait de baisser la consommation globale. Je pointe seulement le fait qu’une baisse drastique de la disponibilité du poisson risque de déplaire aux consommateurs, en l’absence de changements majeurs sur l’ensemble de la filière.
Concernant la qualité du poisson pêché par les chalutiers électriques, puisque Frédéric Le Manach nie avoir tenu les propos rapportés par la presse néerlandaise, j’ai modifié ma formulation initiale pour en rendre compte.
[…] quel est le rapport entre l’utilisation ciblée d’électricité (avec ses dérives, certes) dans les abattoirs et son utilisation non-ciblée et totalement non-discriminatoire dans le milieu naturel ? Réponse : aucun
Bloom se méprend sur le contenu de la question éthique. Ce qui interpelle, c’est ce que ressentent les poissons, raison pour laquelle j’explique que des impulsions électriques sont utilisées sans scandaliser outre mesure dans d’autres contextes. Les éventuels problèmes associés à son utilisation généralisée dans le milieu naturel relèvent davantage des aspects environnementaux faisant l’objet de l’essentiel de notre controverse, pour laquelle j’espère avoir montré que la position de Bloom était largement intenable.
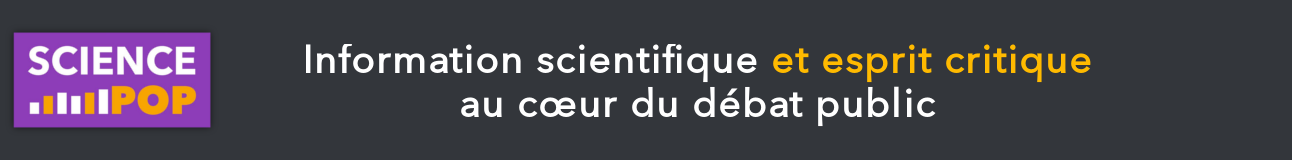





PROUZET
Les travaux portant sur la physiologie des poissons soumis à l’impact d’un champ électrique ont été très bien documentés par des scientifiques de renom dont Lamarque, Vibert, Fontaine, Gosset et il est dommage que Bloom ne les ai pas cités dans son plaidoyer contre la pêche électrique, la plupart de ces chercheurs ont travaillé à l’INRA. Beaucoup de scientifiques qui ont investigué les eaux douces et saumâtres, ont utilisé la pêche électrique comme moyen d’échantillonnage non létal et ce, sur des stades jeunes (salmonidés migrateurs notamment, poissons plats dans les estuaires). Il est vrai que l’on pouvait observer des ruptures de colonne vertébrale sur certains sujets en période de reproduction du fait d’un métabolisme du calcium fortement modifié, mais ceci était généralement constaté quand le poisson touchait l’électrode. La galvanotaxie est un phénomène relativement bien étudié en eau marine (par l’ISTPM, « ancêtre » de l’Ifremer) et en eau douce (par l’INRA). Des expériences de marquage faites sur des juvéniles ont montré le peu d’impact sur leur survie (ces éléments ont été publiés).
Nous pouvons tous converger sur l’évidente nécessité de mener plus d’investigations sur cette pratique de la pêche électrique avant de la développer. Mais le fait de donner une vision catastrophique de cette pratique sans que cela soit étayé est tout à fait contre-productif et ne renseigne que très peu le citoyen désirant en savoir un peu plus pour se forger une opinion en toute connaissance de cause.
Il est vrai également que cette technique de pêche est probablement plus efficace au plan économique et pourrait engendrer à terme une concurrence très défavorable pour les armements de type classique utilisant des arts trainants. C’est à mon avis ce problème qu’il aurait fallu plus développer et qui a pu engendrer un sentiment d’inquiétude pour la pêche française. On peut, sur ce point, citer à titre de comparaison le combat entre les bolincheurs espagnols (senneurs) et les chalutiers pélagiques français pour l’exploitation de l’anchois dans le golfe de Gascogne. Ce conflit a été, en grande partie, résolu par des accords de pêche portant sur des périodes et des zones de pêche particulières pour les deux flottilles, évitant ainsi des conséquences économiques et sociales néfastes pour les deux flottilles dans un cadre de réglementation des prises par quota. Il est dommage que cette possibilité ait été occultée par une analyse de Bloom qui me semble, je vous l’accorde, un peu trop rapide et pas suffisamment étayée.