Homo sapiens est un animal bien particulier : il est capable d’étudier la structure de la matière, de prouver des théorèmes et d’écrire des poèmes. C’est aussi une espèce hautement technologique, qui va jusqu’à fabriquer des machines lui permettant de faire le tour du monde et d’aller dans l’espace.
L’être humain est également l’espèce dominant le reste de la biosphère dont il dépend. L’ampleur des activités humaines sont telles qu’elles menacent directement ou indirectement de nombreuses espèces, et ce depuis des dizaines de milliers d’années. Entre autres, il fut certainement responsable de l’extinction de la mégafaune australienne il y a plus de 40 000 ans, et plus récemment de celles du dodo au 17e siècle, du tigre de Tasmanie en 1936 et du dauphin de Chine en 2006.
Intelligence et bombes chimiques
Ceci dit, à mesure que l’on étudie le reste du monde vivant, on se rend compte que de nombreuses caractéristiques que l’on pensait être propres à l’humain sont en fait partagées avec d’autres espèces. Quand on considère les émotions complexes de nos cousins primates ou l’intelligence impressionnante des corbeaux, on réalise que la distinction humain/animal semble se réduire à une question de gradation. Les autres animaux rivalisent également avec l’humain en ce qui concerne les comportements extrêmement violents et cruels (sans pouvoir par contre appeler la police). L’humain n’a pas été le premier à inventer les armes chimiques. Lorsqu’il se sent menacé, le coléoptère bombardier est en effet capable de provoquer une réaction chimique violente entre de l’hydroquinone et du peroxyde d’hydrogène dans son abdomen, projetant alors un liquide corrosif et brûlant.
De même, l’être humain n’est pas non plus la première espèce à avoir inventé l’agriculture, ni à utiliser des engrais et des pesticides. Certains animaux nous ont largement devancés.
Des fourmis pas comme les autres
Bien avant que les humains ne débutent l’agriculture en Mésopotamie, il y a environ dix mille ans, les fourmis champignonnistes, ou fourmis coupe-feuille, avaient déjà tout inventé. Les espèces appartenant aux genres Atta et Acromyrmex, présentes exclusivement en Amérique, récoltent à l’échelle industrielle des feuilles pour les ramener dans leur fourmilière. Jusque là, rien de bien surprenant en apparence… sauf que ces végétaux ne sont pas comestibles pour les fourmis qui ne savent pas les digérer. Mais alors, pourquoi autant d’efforts de récolte ? En fait, ces feuilles ne sont pas destinées à la consommation des fourmis, mais à celle des champignons qu’elles cultivent.
En effet, à plusieurs mètres sous terre, ces fourmis disposent d’un véritable jardin à champignons, et font donc de la myciculture, ou fongiculture. Les feuilles sont coupées en petits morceaux pour permettre la croissance des champignons qui produisent des excroissances gorgées de sucres et de graisses spécialement pour l’alimentation des fourmis. Au cours de leur évolution conjointe, les fourmis ont ainsi tiré un maximum parti de cette relation de symbiose, en poussant la sélection des champignons dans leur intérêt. Cette situation est similaire à celle des humains qui ont, inconsciemment ou non, amélioré les rendements de l’agriculture en sélectionnant les variétés de plantes sauvages initialement peu productives jusqu’à obtenir aujourd’hui les produits que l’on connaît.
Et ce n’est pas tout, le développement des champignons est favorisé par le dépôt de sécrétions anales des fourmis, agissant comme un engrais. Plus surprenant encore, leurs glandes salivaires ou métapleurales produisent des sécrétions aux propriétés antibiotiques (bactéricide), protégeant ainsi le champignon des bactéries nuisibles. Elles favorisent toutefois la présence d’une bactérie filamenteuse particulière qui produit un fongicide, éliminant les champignons parasites. Manifestement, soit ce fongicide est bien sélectif, soit le champignon cultivé y est résistant (ce qui ne sera pas sans rappeler un équivalent emblématique et décrié de l’agriculture moderne : les plantes OGM résistantes aux herbicides). Bref, les fourmis utilisent des pesticides.
Toutefois, la production de champignons dans un espace confiné représente un risque : ceux-ci dégagent du dioxyde de carbone (CO2), dont l’accumulation au détriment du dioxygène (O2) peut causer l’asphyxie des fourmis. Pour pallier ce problème, les ouvrières mettent en place un système ingénieux de ventilation, à l’aide de conduits communiquant directement avec la surface afin de renouveler l’air.
Conclusion
La culture des champignons par une colonie de fourmis est le résultat de la coopération de millions d’ouvrières hyper-spécialisées, se divisant les tâches de façon optimale, rappelant le taylorisme des humains. Cet exemple rappelle toute la complexité que peut produire l’évolution par sélection naturelle. De manière générale, cette complexité est particulièrement frappante chez tous les insectes sociaux comme les fourmis, les termites ou les abeilles. On dénombre un cinquantaine d’espèces de fourmis champignonnistes, et ce comportement se retrouve chez certaines espèces de termites et coléoptères.
Bien entendu, l’impact environnemental associé à l’agriculture des fourmis n’a rien à voir avec celle des humains, notamment du fait des surfaces monopolisées. L’agriculture, par définition, consiste à faire pousser ou élever des espèces qui nous intéressent au détriment d’autres espèces qui entreraient en concurrence pour l’accès aux nutriments, à l’eau, à la lumière… Quoiqu’il arrive, lorsqu’on convertit un espace naturel en espace agricole productif, cela entraîne mécaniquement une chute drastique de la biodiversité, comme dans la champignonnière des fourmis. Malheureusement, l’empreinte environnementale liée à l’agriculture est amenée à croître, à cause d’une population mondiale en hausse et dont le régime évolue. Cette dynamique est notamment susceptible d’aggraver le changement climatique (l’agriculture étant responsable d’environ un quart des émissions de gaz à effet de serre mondiales). Pour limiter la déforestation et autres destructions d’espaces naturels, il serait entre autres pertinent de lutter agressivement contre le gaspillage, de limiter la consommation de viande bovine et de s’efforcer de conserver des hauts rendements pour produire un maximum en occupant un minimum de surface.
Ci-dessous se trouve un extrait de documentaire de la BBC montrant les différentes étapes décrites chez une espèce champignonniste d’Argentine. Au passage, je conseille vivement aux amateurs de nature les chefs-d’œuvres que sont les documentaires Planet Earth (1 et 2) et Life de la BBC.
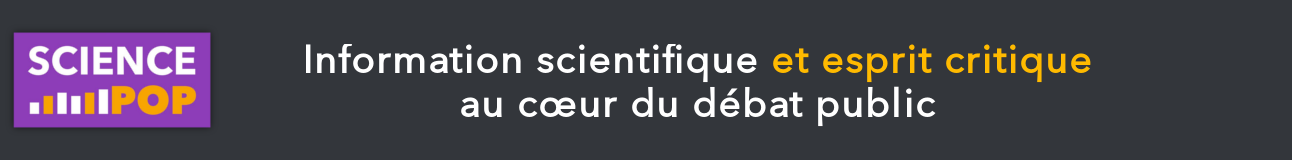







Anonyme
Pourquoi le site s’appelle Science pop?
On y trouve des commentaire de scientifique de haut niveau qui réalisent des joutes a celui qui aura la meilleure biblio ou la meilleure preuve qu’il a raison!…
En quoi est ce pop ?
(et je ne parle pas des gens qui se font rabrouer parce qu’ils n’ont pas de connaissances suffisantes dans un domaine).
C’est drôle non?
Anonyme
Bonjour,
Article intéressant et documenté, merci.
Bien que pas de la partie, je remarque votre analogie avec les OGM.
Il me semble que les fourmis, si elles utilisent un fongicide, un antibiotique, le font en milieu contrôlé, sans incidence sur l’extérieure de la fourmilière ni sur leur santé.
Est ce la cas pour l’homme avec les OGM cultivés ?
(combien d’ogm ne sont que résistants a un herbicide?).
Et la taylorisation n’est elle pas un pâle copie de l’organisation des fourmis?
N’étaient elles pas là avant nous?
Théo
Bonjour,
Les OGM, ils sont effectivement cultivés en plein champ, ce qui pose la question de leur impact. Je vous encourage à consulter le rapport 2016 des académies des sciences américaines (gratuit en téléchargement), qui revient sur les avantages des OGM cultivés et leurs impacts sur les rendements (nuls ou positifs), l’environnement (positifs et négatifs, rien n’étant insurmontable) et la santé (nuls, pour faire court).
Sinon, effectivement il semblerait bien que les fourmis ont développé une forme avancée de division des tâches bien avant l’être humain.
gattaca
En relisant ce commentaire, j’ai réalisé que j’avais laissé passer cette phrase :
« Entre autres, il fut certainement responsable de l’extinction de la mégafaune australienne il y a plus de 40 000 ans… »
Vu le faible nombre d’humains à l’époque qui existait sur terre, et encore plus particulièrement en Australie qui a commencé à être « colonisée » à cette époque, il est totalement invraisemblable que l’homme soit responsable d’une quelconque manière de la disparition de cette mégafaune ! (même s’il a tué quelques animaux pour se nourrir). La disparition de cette mégafaune à cette époque est certainement liée à d’autres facteurs.
Pour donner quelques informations à « Patrick »
Concernant la biodiversité, il faut lire des livres de vrais écologistes préoccupés par la biodiversité tels notamment ceux de Christian Levêque et se référer également à » l’écologie sceptique » de Bjon Lomborg… ce qui permet de dérouler des arguments rationnels et réalistes.
Théo
Merci de votre commentaire.
Votre remarque n’est pas en mesure de remettre en cause le fondement scientifique de cette affirmation. Il vous faudra critiquer de façon convaincante et références à l’appui la source fournie (publication de 2012 résumée dans l’article du Monde) dont la conclusion est renforcée par des preuves convergentes plus récentes (voir par exemple ici et ici).
Notez au passage l’usage de l’adverbe « certainement » dont la signification usuelle laisse paradoxalement une petite part au doute.
Gattaca
Merci de votre réponse !
Commentaires sur les publications auxquelles vous faites référence….
La première est une hypothèse, une autre n’est pas du tout d’accord et propose une hypothèse beaucoup plus probable : celle de feux de broussailles…. se produisant au niveau des nids de ces oiseaux géants et détruisant les oeufs.
1 / 5 (6) Jan 30, 2016
Well few words and common sense needed here : First error in the `assumption based conclusion rather than evidence ` as the researchers own words at their original paper ` We found no in situ hearths or in situ stone artifacts directly associated with burnt Genyornis eggshell, or with similar-age burnt Dromaius eggshell, and only rarely in association with pre-Holocene, post-45 ka burnt Dromaius eggshell » so there is no `direct human association here whatsoever .Second error is the assumption of `Higher temperatures should be created by the ` man made hearths for cooking` then the simple `Bush fire` , well we are talking 200 kg giant bird nest made of lots of thick branches of bush and her eggs are located at the center of this dry bush made nest , if this large nest caught fire due to nearby bush fire and the eggs in the middle of the nest exposed bush fire , there is no doubt the `temperature exposure of the eggs in the middle of the nest will be `equally high
Read more at: https://phys.org/news/2016-01-ancient-extinction-giant-australian-bird.html#jCp
Il faudrait connaitre l’abondance des différentes populations de cette mégafaune par rapport à la population d’humains à l’époque …
L’homme a pu (éventuellement) contribuer à précipiter (accélérer) la disparition de cette mégafaune !
gattaca
Concernant le problème de la biodiversité évoquée dans cet article :
« L’ampleur des activités humaines sont telles qu’elles menacent directement ou indirectement de nombreuses espèces, et ce depuis des dizaines de milliers d’années. Entre autres, il fut certainement responsable de l’extinction de la mégafaune australienne il y a plus de 40 000 ans, et plus récemment de celles du dodo au 17e siècle, du tigre de Tasmanie en 1936 et du dauphin de Chine en 2006. »
Les médias annoncent régulièrement que des milliers voire un million d’espèces (annoncé pour 2050) vont prochainement disparaitre : la fameuse 6ième extinction massive …
Alors que :
* Peu d’espèces ont effectivement disparues (vous ne citez d’ailleurs que 4 exemples).
* moins de 1% des organismes vivants se sont éteints au cours des 4 derniers siècles. Aucune espèce marine n’a disparu ces trente dernières années.
Le vrai problème n’est pas la disparition d’espèces mais la diminution du nombre d’animaux.
L’étude de la biodiversité soufre de graves erreurs méthodologiques :
1) on ne sait pas combien il existe d’espèces
2) on ne sait pas combien disparaissent d’espèces (lié au premier point)
3) on ne sait pas combien apparaissent d’espèces (on en trouve régulièrement de nouvelles et très récemment encore, et/ou des espèces considérées commes disparues sont retrouvées, réapparaissent !)
4) on ne sait pas combien de sous espèces sont présentes au sein d’une même espèce car non identifiées comme telles !
5) affirmation que des espèces non connues ont disparu. Si un grand nombre sont encore inconnus (les experts ne sont pas d’accord entre eux (de 1 million à 100 millions !!!), plus on augmente le nombre d’espèces inconnues, plus on augmente évidemment le nombre d’espèces qui vont disparaître.
Au niveau des gènes qui seraient perdus, c’est assez peu probable ! Seuls quelques uns vraiment spécifiques de l’espèce considérée le seraient mais qui sont sans importance par rapport à tous les gènes indispensables quasiment commun à tout le vivant.
(nous avons 33% de nos gènes en commun avec la levure de boulangerie, 40% avec le cafard, 99% avec le chimpanzé… etc.)
Par ailleurs, des résultats concernant une espèce sont souvent généralisés (extrapolés) à l’ensemble des espèces. Des animaux vivants dans un espace limité sont plus sujet à la vulnérabilité.
Les espèces marines, comme déjà mentionné, sont bien moins menacées que les espèces terrestres (environnement plus tamponné !).
Enfin, il n’est pas nécessairement inquiétant que des espèces disparaissent, c’est peut être leur histoire. L’évolution est surtout remplie d’organismes qui n’ont sans doute jamais perdurer afin de commencer à pouvoir constituer une espèce.
On prête à Einstein une phrase qu’il n’a jamais dite du genre : ‘si les abeilles venaient à disparaître l’humanité n’aurait plus que deux années à vivre’ alors que, de fait, 200 000 espèces animales pollinisent de l’ordre de 225000 espèces de plantes à fleurs (parmi eux beaucoup d’insectes effectivement dont les abeilles mais pas que : mouches, guêpes, les papillons, les coléoptères), sans compter des oiseaux (colibris) ou des chauves-souris.
patrick
Gataca tes remarques me paraissent pertinentes
Peux tu me transmettre tes sources?
Merci
Marie Segura
Bonjour !
Merci pour cet article extrêmement informatif !
Je relève quand même ce qui me semble un biais, en ce qui concerne l’empreinte environnementale de l’agriculture : l’article d’Eshel et al. que vous citez se contente de comparer les coûts environnementaux des produits issus des animaux (viande, oeufs, produits laitiers)… sans inclure les protéines végétales. La méthode me semble contestable: pourquoi ne pas inclure une alimentation végétale? Vous l’aviez fait, d’ailleurs, dans votre infographie en début d’année (https://sciencepop.fr/2017/01/01/5-facons-de-reduire-facilement-son-empreinte-carbone-en-2017/).
D’ailleurs, les chercheurs semblent eux-mêmes comprendre les limites de leur article, puisque la conclusion indique clairement que pour réduire le coût environnemental de l’alimentation, il convient de réduire tous les produits issus des animaux (« it is clear that policy decisions designed to reduce animal-based food consumption stand to significantly reduce the environmental costs of food production (55) while sustaining a burgeoning populace »).
Théo
Merci de votre retour !
L’article mis en lien est là pour justifier l’affirmation qu’il serait judicieux de réduire la consommation de viande rouge sur le critère des surfaces cultivées, étant donné l’énorme écart qui demeure entre le bœuf et les autres viandes. Il va de soit que la production de calories d’origine végétale plutôt qu’animale sera généralement bénéfique à plusieurs niveaux, surtout si vous faites pousser des plantes exprès pour nourrir les animaux (cf. pyramide écologique).